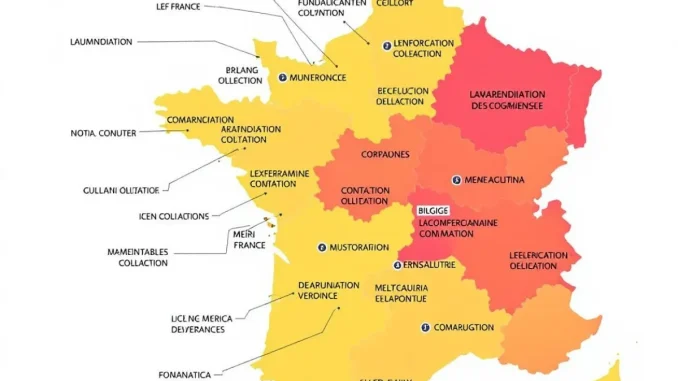
Face à l’engorgement des tribunaux français, la médiation s’impose progressivement comme un préalable obligatoire à de nombreuses actions en justice. Cette évolution majeure du paysage juridique français vise à promouvoir les modes alternatifs de résolution des conflits, désengorger les juridictions et favoriser des solutions amiables plus rapides et moins coûteuses. Mais quels sont précisément les litiges soumis à cette obligation préalable de médiation? Entre les réformes successives et l’extension constante du champ d’application, il devient complexe pour les justiciables et les professionnels du droit d’identifier clairement les contentieux concernés. Cet état des lieux détaillé propose une cartographie complète des situations où la médiation constitue désormais un passage obligé avant toute saisine du juge.
Le cadre juridique de la médiation obligatoire en France
La médiation se définit comme un processus structuré par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur. Longtemps facultative, elle devient progressivement obligatoire dans certains domaines contentieux, sous l’impulsion du législateur français et européen.
L’émergence de la médiation obligatoire en France trouve sa source dans plusieurs textes fondateurs. La directive européenne 2008/52/CE du 21 mai 2008 a posé les premières bases en encourageant le recours aux modes alternatifs de règlement des conflits. En droit interne, la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a constitué un tournant majeur, suivie par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice qui a considérablement élargi le champ d’application de la médiation préalable obligatoire.
Plus récemment, la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a renforcé cette tendance. Le décret n°2022-245 du 25 février 2022 a précisé les modalités d’application de la médiation préalable obligatoire pour certains contentieux.
Les principes directeurs de la médiation
Même lorsqu’elle est obligatoire, la médiation repose sur des principes fondamentaux qui garantissent son efficacité et sa légitimité :
- La confidentialité des échanges
- L’impartialité et la neutralité du médiateur
- Le consentement des parties à la solution trouvée
- La compétence du médiateur dans le domaine concerné
La Cour de cassation a rappelé dans plusieurs arrêts l’importance de ces principes, notamment dans un arrêt du 11 mars 2020 (Civ. 1ère, n°19-13.716) où elle souligne que « la médiation, même obligatoire dans son principe, demeure libre dans son déroulement et sa conclusion ».
L’objectif du législateur n’est pas d’imposer un accord à tout prix, mais de contraindre les parties à explorer la voie amiable avant de saisir le juge. Cette nuance est fondamentale : ce n’est pas le résultat qui est obligatoire, mais la démarche préalable. Les parties conservent leur liberté de ne pas aboutir à un accord et de poursuivre ensuite la voie judiciaire.
Les litiges familiaux soumis à la médiation préalable obligatoire
Le droit de la famille constitue un terrain privilégié pour l’expérimentation et le développement de la médiation obligatoire. Les relations familiales, par leur dimension émotionnelle et leur caractère durable, se prêtent particulièrement bien à une approche amiable des conflits.
Depuis la loi du 23 mars 2019, l’article 373-2-10 du Code civil prévoit que le juge peut enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur familial pour les informer sur l’objet et le déroulement de la médiation. Cette disposition a été renforcée par l’introduction d’une phase de médiation préalable obligatoire pour certains contentieux familiaux spécifiques.
La modification des mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale
L’article 7 du décret n°2019-1380 du 17 décembre 2019 a rendu obligatoire, à titre expérimental dans certains tribunaux, la tentative de médiation préalable pour les demandes de modification des dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale. Cette expérimentation, initialement prévue jusqu’au 31 décembre 2022, a été prolongée et étendue à d’autres juridictions.
Sont concernées les demandes de modification des décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. En pratique, cela inclut les demandes de modification du droit de visite et d’hébergement, du lieu de résidence habituelle des enfants, ou encore du montant de la pension alimentaire.
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 5 février 2021, a confirmé le caractère irrecevable d’une demande non précédée d’une tentative de médiation dans les juridictions concernées par l’expérimentation. Cette fin de non-recevoir peut être soulevée d’office par le juge aux affaires familiales.
Les exceptions à la médiation obligatoire en matière familiale
Le législateur a prévu des exceptions à cette obligation de médiation préalable en matière familiale, notamment dans les cas suivants :
- Existence d’un motif légitime (éloignement géographique excessif, coût disproportionné, etc.)
- Présence de violences conjugales ou intrafamiliales
- Demande conjointe des parties de passer outre la médiation
- Urgence manifeste nécessitant une intervention judiciaire immédiate
Ces exceptions sont interprétées strictement par les juges. Ainsi, dans une décision du Tribunal judiciaire de Nanterre du 3 septembre 2021, le juge a rappelé que « la simple allégation de difficultés de communication entre les parties ne constitue pas un motif légitime permettant de s’affranchir de l’obligation de médiation préalable ».
Les litiges de voisinage et la conciliation obligatoire
Les conflits de voisinage représentent une part significative du contentieux civil de proximité. Leur caractère quotidien et leur impact sur la qualité de vie des justiciables ont conduit le législateur à les soumettre à une tentative préalable de règlement amiable.
L’article 4 de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 a modifié l’article 4 du Code de procédure civile pour rendre obligatoire la tentative de résolution amiable préalable pour les litiges dont la valeur n’excède pas 5 000 euros, ainsi que pour certains conflits de voisinage indépendamment de leur montant.
Les troubles anormaux de voisinage
La théorie des troubles anormaux de voisinage, construction jurisprudentielle bien établie en droit français, concerne des nuisances dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Depuis 2019, les actions fondées sur cette théorie doivent être précédées d’une tentative de résolution amiable.
Sont notamment concernés les litiges relatifs aux :
- Nuisances sonores (bruits répétitifs, musique, travaux…)
- Plantations (arbres, haies dépassant les hauteurs réglementaires)
- Écoulements d’eau entre propriétés voisines
- Vues et jours non conformes aux distances légales
- Odeurs ou fumées incommodantes
La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 janvier 2022 (Civ. 3ème, n°20-17.697), a confirmé l’irrecevabilité d’une action en trouble anormal de voisinage non précédée d’une tentative de conciliation ou de médiation, rappelant que cette fin de non-recevoir est d’ordre public.
Les litiges relatifs aux servitudes et aux limites de propriété
Les contentieux relatifs aux servitudes et aux limites de propriété sont particulièrement adaptés à la résolution amiable. L’article 1242 du Code de procédure civile prévoit que les actions en bornage ou en reconnaissance de servitude doivent, à peine d’irrecevabilité, être précédées d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice.
Cette obligation s’applique notamment aux litiges concernant :
Les servitudes de passage, particulièrement fréquentes en zone rurale ou dans les propriétés enclavées, font l’objet d’un nombre significatif de médiations réussies. Selon les statistiques du Ministère de la Justice, le taux de réussite des médiations dans ce domaine avoisine les 70% lorsqu’elles sont menées par des médiateurs spécialisés.
Les tribunaux judiciaires vérifient systématiquement le respect de cette obligation préalable. Dans une décision du 15 mars 2021, le Tribunal judiciaire de Lyon a déclaré irrecevable une demande relative à une servitude de vue, faute de justification d’une tentative préalable de résolution amiable.
Les litiges de consommation et la médiation sectorielle obligatoire
Le domaine de la consommation constitue un secteur où la médiation obligatoire s’est particulièrement développée, sous l’impulsion du droit européen et dans une logique de protection du consommateur.
La directive 2013/11/UE du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, transposée en droit français par l’ordonnance n°2015-1033 du 20 août 2015, a généralisé l’accès des consommateurs à des dispositifs de médiation pour tous les litiges nationaux et transfrontaliers avec des professionnels.
Les secteurs d’activité soumis à une médiation obligatoire
Certains secteurs économiques sont soumis à une obligation particulière de proposer un dispositif de médiation aux consommateurs. L’article L.612-1 du Code de la consommation impose à tout professionnel de garantir au consommateur le recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation.
Parmi les secteurs où la médiation est particulièrement structurée et effective, on trouve :
- Le secteur bancaire et financier, avec le Médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers et les médiateurs bancaires
- Les communications électroniques et la téléphonie, avec le Médiateur des communications électroniques
- L’énergie, avec le Médiateur national de l’énergie
- Les transports, avec le Médiateur Tourisme et Voyage
- Le commerce en ligne, avec la plateforme européenne de règlement en ligne des litiges
Ces dispositifs sectoriels présentent la particularité d’être obligatoires pour les professionnels, qui doivent adhérer à un système de médiation et en informer les consommateurs, mais facultatifs pour les consommateurs qui conservent le droit de saisir directement le juge.
La médiation des litiges de consommation en pratique
En pratique, la médiation de la consommation suit un processus bien défini. Le consommateur doit d’abord adresser une réclamation écrite au professionnel. Ce n’est qu’en cas d’échec de cette démarche qu’il peut saisir le médiateur compétent, dans un délai d’un an à compter de sa réclamation écrite.
La Commission d’Évaluation et de Contrôle de la Médiation de la Consommation (CECMC) veille à l’impartialité, la compétence et l’efficacité des médiateurs référencés. Selon son rapport d’activité 2022, plus de 120 000 saisines de médiateurs de la consommation ont été enregistrées, avec un taux de résolution amiable avoisinant les 60%.
La Cour de justice de l’Union européenne a précisé, dans un arrêt du 14 juin 2017 (C-75/16), que « si la directive 2013/11 n’impose pas aux consommateurs de recourir à la médiation avant toute action judiciaire, elle n’interdit pas aux États membres d’adopter une législation rendant le recours à la médiation obligatoire, à condition que celle-ci ne fasse pas obstacle au droit d’accès au système judiciaire ».
Les contentieux administratifs et la médiation préalable obligatoire
L’extension de la médiation obligatoire au domaine du droit administratif marque une évolution significative dans la conception des relations entre l’administration et les administrés. Longtemps considéré comme peu propice aux modes alternatifs de résolution des conflits, le contentieux administratif s’ouvre progressivement à la médiation.
La loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 a introduit dans le Code de justice administrative des dispositions relatives à la médiation. L’article L.213-5 de ce code permet d’expérimenter une procédure de médiation préalable obligatoire pour certains contentieux administratifs.
Les litiges relatifs à la fonction publique
Le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 a pérennisé et étendu le dispositif de médiation préalable obligatoire pour certains litiges de la fonction publique et litiges sociaux. Cette obligation concerne notamment :
- Les décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération des agents publics
- Les refus de détachement, de mise en disponibilité ou de congés non rémunérés des agents contractuels
- Les décisions relatives à la réintégration à l’issue d’un détachement, d’une disponibilité ou d’un congé parental
- Les décisions relatives au classement lors d’un avancement de grade ou à la promotion interne
- Les décisions d’attribution de certaines primes et indemnités
Le Conseil d’État, dans une décision du 27 mars 2019 (n°426472), a confirmé la légalité du dispositif expérimental de médiation préalable obligatoire, considérant qu’il ne portait pas atteinte au droit à un recours effectif dans la mesure où il n’imposait qu’une formalité préalable accessible et gratuite.
Les contentieux sociaux soumis à médiation préalable
Certains contentieux sociaux relevant de la compétence des juridictions administratives sont soumis à une médiation préalable obligatoire. Il s’agit notamment des recours contre les décisions relatives :
Au revenu de solidarité active (RSA)
À l’aide personnalisée au logement (APL)
À l’allocation aux adultes handicapés (AAH)
À la prime d’activité
Ces médiations sont confiées au Défenseur des droits ou aux centres communaux d’action sociale (CCAS) habilités à cet effet. L’objectif est à la fois de désengorger les tribunaux administratifs et de permettre une résolution plus humaine et individualisée des litiges sociaux, souvent complexes et impliquant des personnes en situation de vulnérabilité.
Selon les chiffres du Défenseur des droits, environ 75% des médiations engagées dans ces domaines aboutissent à une solution satisfaisante pour l’administré, souvent par une meilleure explication de la décision administrative ou par la correction d’erreurs matérielles.
Les perspectives d’évolution de la médiation obligatoire en France
La tendance à l’extension du champ de la médiation obligatoire semble se confirmer, avec plusieurs projets et expérimentations en cours qui pourraient aboutir à de nouvelles catégories de litiges concernés dans les années à venir.
Cette évolution s’inscrit dans une politique judiciaire plus large visant à promouvoir ce que le Garde des Sceaux a qualifié de « justice apaisée », moins confrontationnelle et plus axée sur la recherche de solutions consensuelles. Les résultats encourageants des premières expérimentations alimentent cette dynamique d’extension.
Les expérimentations en cours et les nouveaux domaines potentiels
Plusieurs expérimentations sont actuellement menées dans différentes juridictions françaises, qui pourraient préfigurer une extension du champ de la médiation obligatoire à de nouveaux types de contentieux :
- Les litiges liés au droit du travail, notamment pour certains contentieux prud’homaux
- Les conflits relatifs aux copropriétés, particulièrement adaptés à la médiation
- Les contentieux liés à l’exécution des contrats commerciaux
- Certains aspects du contentieux locatif
- Les litiges liés à la responsabilité médicale
Le rapport « Justice pour le XXIe siècle » remis au Ministre de la Justice en janvier 2023 préconise notamment d’étendre la médiation préalable obligatoire à l’ensemble des litiges commerciaux dont la valeur est inférieure à 10 000 euros, ainsi qu’aux litiges entre associés dans les sociétés non cotées.
Les défis et enjeux de la généralisation de la médiation obligatoire
La généralisation de la médiation obligatoire soulève plusieurs défis que le législateur et les praticiens devront relever :
La formation des médiateurs constitue un enjeu majeur. Face à l’augmentation prévisible du nombre de médiations, il devient nécessaire de former davantage de médiateurs qualifiés et spécialisés dans les différents domaines du droit. La Fédération Nationale des Centres de Médiation (FNCM) estime qu’il faudrait former environ 5 000 médiateurs supplémentaires dans les cinq prochaines années pour répondre aux besoins.
Le financement de la médiation représente un autre défi de taille. Pour être accessible à tous, la médiation obligatoire doit être proposée à un coût raisonnable, voire prise en charge pour les justiciables les plus modestes. Des réflexions sont en cours sur l’extension de l’aide juridictionnelle à la médiation obligatoire et sur la création d’un fonds national de la médiation.
L’information des justiciables sur l’existence et les modalités de la médiation obligatoire doit être améliorée. Une étude du Ministère de la Justice de 2022 révèle que moins de 30% des justiciables connaissent l’existence des dispositifs de médiation obligatoire dans leur domaine.
Le respect de l’accès au juge, droit fondamental garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, doit être préservé. La médiation obligatoire ne doit pas constituer un obstacle disproportionné à la saisine du juge, mais une simple étape préalable raisonnable.
Dans un arrêt du 26 mars 2020 (n°18-11.776), la Cour de cassation a rappelé que « si le législateur peut imposer une phase préalable de médiation obligatoire, celle-ci ne saurait constituer une entrave substantielle au droit d’accès au juge, ce qui implique que son coût reste modéré et que sa durée soit raisonnable ».
Cette évolution vers une généralisation de la médiation obligatoire s’inscrit dans une tendance européenne plus large. La Commission européenne a publié en 2021 une recommandation encourageant les États membres à développer les mécanismes de médiation préalable obligatoire, tout en garantissant leur conformité avec les principes fondamentaux du droit à un procès équitable.
Aspects pratiques : comment satisfaire à l’obligation de médiation préalable
Face à la multiplication des hypothèses de médiation obligatoire, il devient fondamental pour les justiciables et leurs conseils de maîtriser les aspects pratiques permettant de satisfaire à cette obligation préalable, sous peine de voir leur action judiciaire déclarée irrecevable.
La mise en œuvre de la médiation obligatoire obéit à des règles procédurales spécifiques qui varient selon le type de contentieux concerné. Plusieurs questions pratiques se posent : comment prouver que l’obligation a été respectée ? Quels sont les coûts associés ? Comment choisir le bon médiateur ?
Les démarches à accomplir pour satisfaire à l’obligation
Pour satisfaire à l’obligation de médiation préalable, plusieurs démarches doivent être accomplies :
- Identifier le médiateur compétent selon le type de litige (médiateur familial, conciliateur de justice, médiateur de la consommation…)
- Adresser une demande formelle de médiation, généralement par courrier recommandé avec accusé de réception
- Informer l’autre partie de cette demande, sauf dans les dispositifs où c’est le médiateur qui se charge de cette information
- Participer à au moins une réunion d’information sur la médiation, qui constitue souvent le minimum requis pour considérer que l’obligation est satisfaite
La preuve de l’accomplissement de ces démarches est fondamentale. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, notamment un arrêt du 11 mars 2020 (Civ. 1ère, n°19-13.716), « il appartient à celui qui saisit le juge de justifier avoir accompli la tentative de résolution amiable préalable à laquelle il était tenu ».
Cette preuve peut être apportée par différents moyens :
Le procès-verbal établi par le médiateur constatant la tentative de médiation et son échec
L’attestation délivrée par le médiateur certifiant que la partie a bien participé à au moins une séance de médiation
La copie des courriers recommandés invitant l’autre partie à participer à une médiation, accompagnée de la preuve de son refus ou de son silence persistant
Les coûts et la prise en charge financière
Le coût de la médiation varie considérablement selon le type de contentieux et le médiateur choisi :
Pour les médiations familiales, le coût est généralement calculé selon un barème national tenant compte des revenus des parties. Il peut varier de la gratuité pour les personnes aux revenus modestes jusqu’à environ 150 euros par séance pour les revenus les plus élevés.
Les conciliations menées par les conciliateurs de justice sont entièrement gratuites, ce qui en fait une solution privilégiée pour les litiges de voisinage et les petits litiges civils.
La médiation de la consommation est gratuite pour le consommateur, son coût étant pris en charge par les professionnels qui ont l’obligation d’adhérer à un système de médiation.
Pour les médiations conventionnelles menées par des médiateurs privés, les honoraires peuvent varier considérablement, généralement entre 150 et 300 euros de l’heure, partagés entre les parties.
Plusieurs dispositifs permettent d’alléger la charge financière de la médiation :
L’aide juridictionnelle peut, sous certaines conditions, prendre en charge les frais de médiation pour les personnes aux revenus modestes.
Certaines assurances de protection juridique incluent désormais la prise en charge des frais de médiation obligatoire.
Des associations et structures institutionnelles proposent des médiations à tarif social ou gratuites dans certains domaines.
La question du coût reste néanmoins un enjeu majeur pour garantir l’effectivité de l’accès à la médiation. Le Conseil national des barreaux a d’ailleurs alerté sur le risque que la médiation obligatoire devienne un obstacle financier à l’accès au juge si des mécanismes de prise en charge adaptés ne sont pas développés.
En définitive, la médiation obligatoire, malgré les contraintes procédurales qu’elle impose, peut représenter une opportunité pour les justiciables d’obtenir une résolution plus rapide, moins coûteuse et souvent plus satisfaisante de leurs litiges. Les statistiques du Ministère de la Justice indiquent que 70% des médiations aboutissent à un accord, et que 90% de ces accords sont spontanément exécutés par les parties, ce qui témoigne de l’efficacité de cette approche amiable des conflits.
